Nous
collectionnons ces petits récipients de verre et autres
matières qui ont permis de nourrir les tout-petits...
sachant téter. Certains bébés
« tombent trop tôt du nid » ou naissent avec des
malformations labiales (lèvres) et/ou palatine (palais),
ce qui empêche le nouveau-né de téter correctement avec
risque élevé de fausse route. En feuilletant mes
ouvrages anciens sur l’alimentation du nourrisson, il y
a très souvent à la fin du livre un petit chapitre sur
la prise en charge du nouveau-né prématuré. Peu de
détails pour la plupart car nous en sommes qu’aux
balbutiements de la néonatologie, mais néanmoins
intéressant : comment faire boire du lait à un (très)
petit être humain qui n’a pas ou peu acquis des réflexes
de succion dû à son immaturité neurologique. Les
méthodes ont été diverses et certaines ont toujours
cours aujourd’hui mais avec des matériaux « modernes »
et si quelques une nous paraissent inadaptées, elles ont
néanmoins le mérite d‘avoir sauvé des enfants.
« Il est si rare de voir un enfant dans la suite qui est
véritablement né à sept mois, que de mille à peine s’en
rencontre un seul qui échappe. »
Mauriceau, 1721.
Au milieu du 19ème
s. à la Maternité de Paris, un enfant sur 19 naît
prématurément, et ceux, dont la grossesse a été menée à
terme, sont de poids et tailles inférieurs à la normale.
La cause des accouchements précoces sont les conditions
de vie des mères : la misère, les travaux à la
manufacture, l’alcoolisme, les maladies pulmonaires,
mais la syphilis se retrouve au 1er rang.
La néonatologie
est une discipline qui a vu le jour dans les années 1850
: « comment protéger, sauver le petit d’homme venu au
monde trop tôt ? ». Des hommes de sciences, affectés par
la forte mortalité des enfants nés avant terme, vont
effectués des travaux pour les alimenter. Avant le
milieu du XIX è, tout enfant ayant des difficultés de
nutrition était voué à une mort certaine. C’est à cette
même période que la première couveuse va voir le jour,
combinant ainsi alimentation et thermorégulation. Elle
connaît depuis plus de cinq décennies un formidable
essor, ses besoins s’adaptant au progrès techniques dont
la médecine ne cesse de bénéficier.
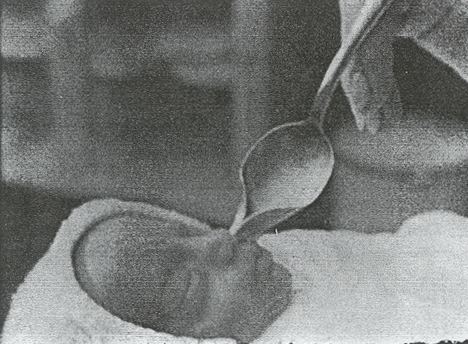 |
|
On a
mis en évidence dans les années 1890 la
différence entre un enfant ayant le réflexe de
succion mais trop faible pour s’alimenter et un
enfant dont le stade d’immaturité neurologique
ne lui permettait pas d’avoir ce réflexe.
La 1ère
description de gavage date de
1852 , a été
expérimentée par un certain Marchant (de
Charenton), mais
source non trouvée pour la méthode.
1°
En 1853, un procédé du nom de « Henriette »
(Dr Henriette, Bruxelles) a été utilisé
jusque dans les années 1930. L’enfant tenu
horizontalement, le lait était versé
alternativement dans une narine puis
l’autre à l’aide d’une cuillère dont
l’extrémité comportait un petit goulot afin
de faciliter l’écoulement du liquide. Le
lait
était
entraîné par l’air de l’inspiration dans les
fosses nasales, et provoquait dans le
pharynx des mouvements de déglutition.
Henriette remplaça plus tard sa cuillère
contre une seringue ou un compte-gouttes. Ce
procédé néanmoins délicat était très
encourageant à ses débuts car il permis de
sauver aussi des enfants atteints de brûlure
du pharynx, de malformation
bucco-pharyngée,
muguet... Mais ce mode d’allaitement assez
courant, avec
l’inconvénient
d’être à la portée de mains non
expérimentées, provoquait parfois
éternuements, toux et risquait de développer
une broncho-pneumonie lorsqu’il y avait
absence de déglutition.
Gavage par le nez à l’aide d’une cuillère. 1er
tiers du 20ème s. |
2°
Un « biberon aérogène » a été mis au point fin 19ème
s. (années 1890) pour alimenter les nourrissons ne
pouvant téter. Le lait était éjecté dans la bouche de
l’enfant à l’aide une pelote en caoutchouc adapté à l’un
des orifices du biberon. La seule pression de cette
boule, combinée avec le jeu d’une soupape disposée à
l’extrémité du tube plongeur, suffisait à faire
parvenir le lait à la bouche de l’enfant. L’injection du
lait pouvait se faire aussi par les narines. Pas de
gravure de ce biberon.
 |
|
 |
|
Biberon « Rémond
» pour prématuré sachant téter. 1950. |
|
Tétines pour prématurés. Angleterre.
1940-1960. |
3°
Procédé des deux cuillères : employé pour la 1ère
fois par Mme Mirzayants
(Marseille). Le principe consistait à introduire dans la
bouche de l’enfant l’extrémité d’une petite cuillère que
l’on maintenait en place légèrement inclinée, et, à
l’aide d’une seconde cuillère, on versait dans la
première, comme dans un petit entonnoir, la quantité de
lait nécessaire pour le repas. Le lait, conduit par la
première cuillère comme par une gouttière, arrivait
jusqu’au pharynx qui, par action réflexe, se
contractait. L’enfant faisait de petits mouvements de
succion et de déglutition. Ce procédé, si commode
soit-il, fut peu usité.
Des médecins
américains ont préconisé d’utiliser des pipettes au lieu
de
cuillères
dans les années 1940.
|
 |
|
 |
|
Pipette compte-goutte munie d’une poire en
caoutchouc. 1er tiers du 20ème
s. |
|
Compte-goutte. Angleterre. 1970-1980. |
L’utilisation
d’une cuillère pour nourrir un enfant n’ayant pas la
force de téter mais avec réflexes de déglutition s’est
largement démocratisée durant un siècle (années
1850-1950).
|
 |
|
 |
|
Alimentation à la cuillère, USA 1940. |
|
Cuillères dont l’extrémité permet une
meilleure préhension buccale et réduit le
diamètre du débit du lait.
Mais peut-être ces objets ont-ils aussi été
utilisés pour le gavage par le nez. |
4°
Le gavage ou nutrition entérale
telle que nous le connaissons aujourd’hui a été mise au
point par Tarnier (chirurgien et obstétricien, inventeur
des forceps !). Cette méthode de nutrition a été
introduite à la
Maternité le 22 mars 1884. Tarnier n’est pas l’inventeur
du procédé de gavage mais l’a perfectionné et vulgarisé
son emploi. « L’appareil de gavage se compose tout
simplement d’une sonde en caoutchouc rouge identique à
celle utilisée pour le gavage et lavage de l’estomac de
l’adulte mais dont le diamètre est réduit, au bout de
laquelle on ajoute une cupule de verre, type bout de
sein artificiel, ou un petit entonnoir en verre gradué.
» 15 à 20 cm de sonde était introduite dans l’oesophage
du nourrisson, et le lait était versé ou injecté
lentement à l’aide d’une seringue dans par son orifice.
L’entretien du tube se faisait après chaque gavage par
un trempage dans une solution d’acide borique.
|
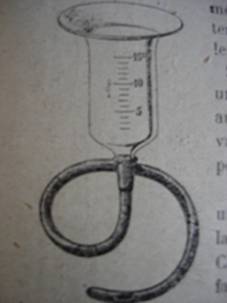 |
|
 |
|
 |
|
Entonnoir gradué muni d’une sonde. Fin 19ème
s. |
|
Bout de sein en verre muni d’une sonde. Fin
19ème s. |
|
Gavage à l’aide d’une sonde. Etats-Unis.
1940. |
Les premières
sondes utilisées n’avaient pas le diamètre
d’aujourd’hui. La sonde était introduite par la bouche à
chaque gavage, provoquant nausées et vomissements. Le
passage répétitif d’une sonde dans l’œsophage provoque à
très cours terme des lésions. Aucune mention à ce sujet
n’est évoquée dans les ouvrages traitant de
l’alimentation du prématuré. L’introduction de la sonde
par le nez a été expérimentée mais très souvent
impossible du fait de l’étroitesse de la cloison nasale.
Avec l’apparition de nouveaux matériaux, le diamètre des
sondes de gavage s’est considérablement réduit pour un
plus grand confort des tout-petits.
Aujourd’hui,
nous n’utilisons plus le terme « gavage », il a été
remplacé par « nutrition entérale
».